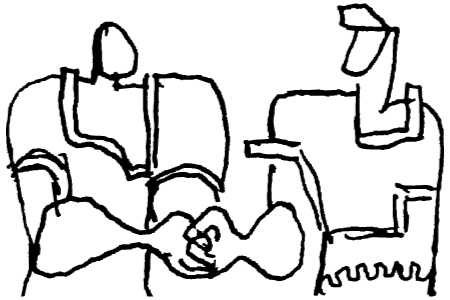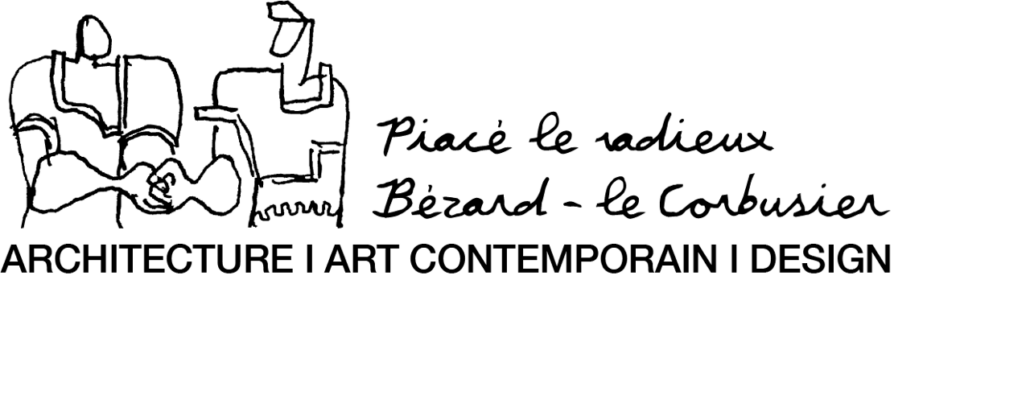Votre panier est actuellement vide !
Lois Weinberger
Capsule radieuse • LOIS WEINBERGER
Du 21 septembre au 20 octobre 2019
Avec la complicité de la Galerie Salle Principale; Paris
Vernissage dimanche 20 septembre à partir de 11h30
Repas Barbecue*
Concert Bob Corn (folk) 15h30
Né au sein d’une famille de paysans dans le Haut-Tyrol autrichien, Lois Weinberger entreprend dès le début des années 1970, un travail poétique et politique portant sur notre environnement direct qu’il soit naturel ou remanié par l’homme. Son regard se tourne vers une nature libre et spontanée dont il révèle des zones marginales.
Les plantes rudérales – « Weeds » – communément appelées mauvaises herbes, sont à l’origine d’une oeuvre protéiforme riche de dessins, photographies, objets textes, films, oeuvres organiques en évolution permanente et installations dans l’espace public. Son travail pionnier a largement contribué à la discussion sur l’art et la nature amorcée dans les années 1990. L’artiste est représenté par la galerie Salle Principale (Paris).
Lois Weinberger, le paysan anartiste, poétique du pagus
Texte de Guy Tortosa écrit à l’occasion de l’exposition
https://www.salleprincipale.com/galerie
http://www.loisweinberger.net/
Exposition au Moulin de Blaireau
Samedi & Dimanche 14h30-18h30
Œuvres en extérieur dans le village:
Portable garden, 1994 | installation | prêt du CNAP – Centre National des arts plastiques
I-Weed…, 2004 | peinture murale
Holding the earth, 2010 et Porte de Brandenburger Tor, 1994 | affiches